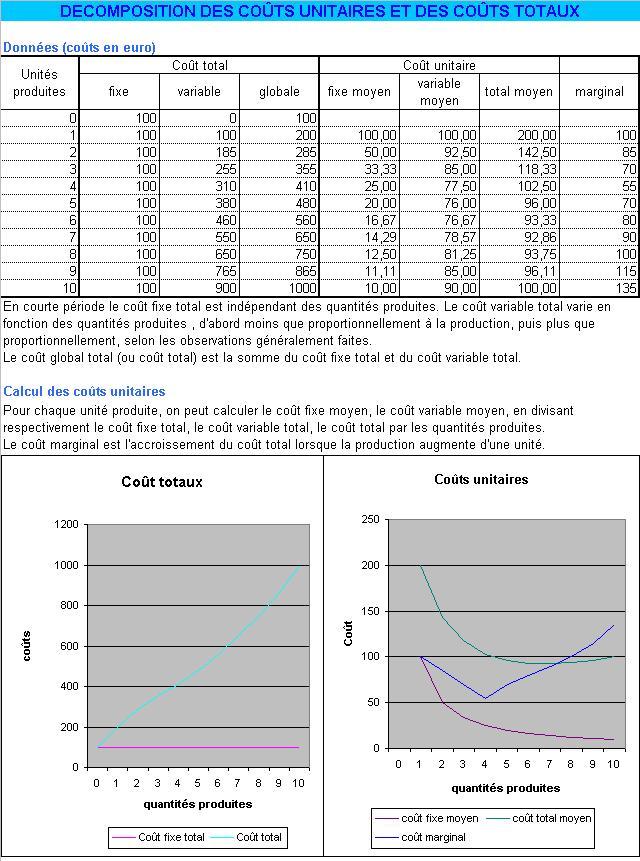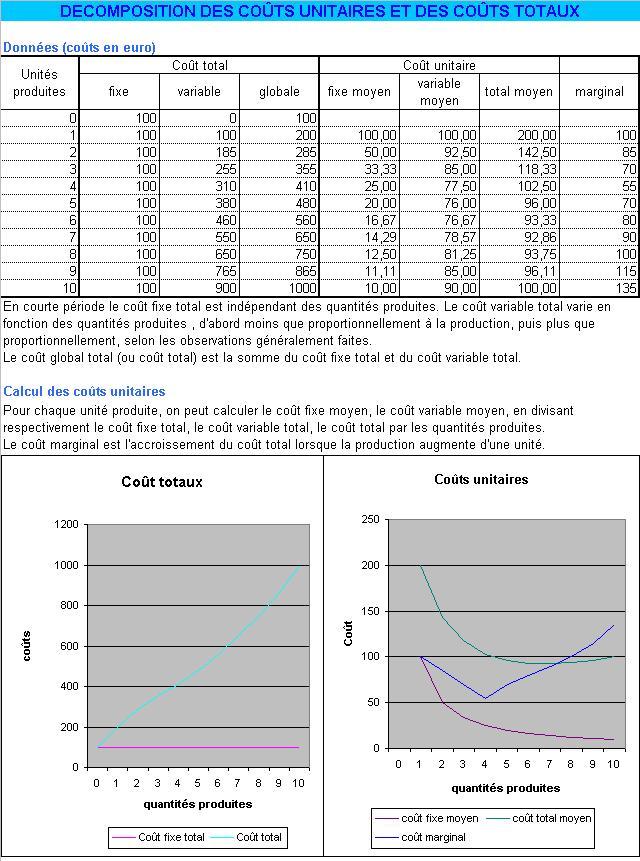Charges variables, charges fixes
La distinction
entre charges directes et indirectes est une démarche comptable,
conduisant à des calculs arbitraires dans la mesure où il
est décidé de répartir toutes les charges incorporables
entre les coûts. Il est utile, en contrôle de gestion, de faire
une distinction, de caractère économique, entre les charges
variables et les charges fixes.
Les charges de structure (ou charges structurelles)
Ce sont les charges qui sont liées à l'existence même
de l'entreprise, donc à sa capacité de production, et qui,
à technologie fixée, sont stables quel que soit le niveau
d'activité de l'entreprise.
en comptabilité analytique, où la période de calcul
est courte, on peut faire l'hypothèse que la capacité de
production ne se modifie pas et que les charges structurelles sont des
charges fixes.
En longue période, les charges structurelles varient par palier,
chaque passage d'un palier à l'autre correspond à un changement
de structure dans l'entreprise.
Elles comprennent, par exemple, les loyers, les primes d'assurance, les
dotations aux amortissements, les frais administratifs: que l'entreprise
fonctionne ou non, ces charges ne sont pas susceptibles de se modifier
sur une courte période.
Les charges bimestrielles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles
sont réparties également entre les différents mois
selon la méthode de l'abonnement des charges.
Les charges opérationnelles
Ce sont les charges "qui varient avec le volume d'activité de l'entreprise,
sans qu'il y ait nécessairement exacte proportionnalité entre
la variation des charges et la variation du volume des produits obtenus"
(PCG 82). Elles sont aussi appelées charges d'activité.
Ces charges opérationnelles constituent des charges variables.
pour simplifier, les comptables les considèrent comme proportionnelles
au chiffre d'affaires, qui mesure l'activité. Dans la réalité,
les charges variables peuvent varier proportionnellement, ou plus proportionnellement,
ou moins proportionnellement à l'activité. Il a été
admis, à la suite d'observations, que lorsqu'on augmente les quantités
d'un facteur de production, le travail par exemple, les autres facteurs
n'étant pas modifiés, il apparaît d'abord une phase
de rendements croissants (= coûts moins que proportionnels), suivie
d'une phase de rendements décroissants (= coûts plus que proportionnels)
Exemples de charges variables
Les consommations de matières sont à peu près proportionnelles
à la production; les commissions des représentants comprennent
généralement une partie fixe et une partie proportionnelle
au CA réalisé. D'autres charges sont variables sans liaison
aussi stricte, comme les matières consommables, l'énergie,
etc....
La notion de coût marginal
Dans une entreprise faisant varier sa production par séries, pour
un niveau de production donné, le coût marginal est égal
au coût de la dernière série fabriquée pour
atteindre ce niveau.
A partir de ce coût marginal de série, peut être
calculé le coût marginal unitaire de la série
en divisant le coût marginal de la série par le nombre d'unités
de ladite série. Si l'entreprise peut faire varier sa production
unité par unité, la série se réduit à
une unité.
Mathématiquement, le coût marginal est une fonction des
quantités produites égale à la dérivée
de la fonction coût total.
Il en résulte que lorsque le minimum du coût moyen est
atteint, le coût marginal lui est égal.
Décomposition des coûts unitaires et des coûts totaux
Ce tableau, vous permettra de calculer l'évolution des coûts
en fonction des quantités produites avec vos propres données.
Des graphiques illustrant ces données évoluent avec vos chiffres.
Si vous utilisez internet explorer, vous pouvez ouvrir ou importer la
feuille excel en cliquant sur l'image, si vous utilisez Netscape Navigator
il vous faudra d'abord ouvrir votre tableur excel, puis ouvrir " www.chez.com/controlegestion/chargesvar.xls
".